|
Gai, gai, marions-nous !

Sachez tout d'abord qu'il est arrivé au moins 66 fois que
deux mariages, concernant des membres de notre famille, soient
célébrés le même jour. Si le 1er
décembre 1759 ce fut dans la même église,
- celle de Léglise en l'occurrence -, généralement
cela s'est produit dans des lieux, voire dans des pays différents.

Mais
nous avons fait beaucoup mieux le 10 août 1974 ! Figurez-vous
que ce jour-là, trois mariages "Deum" furent
fêtés :
- En Belgique,
Jacqueline épousait Bernard à Anlier,
- En France,
à Sérignac dans le Lot-et-Garonne, Philippe unissait
sa destinée à celle de Ginette, et...
- Au Québec,
à Boucherville près de Montréal, Sylvie
convolait en justes noces avec Jacques !
À
propos du Québec, savez-vous qu'en 1871 on y recensait
la bagatelle de 508 paroisses dont 143 se trouvaient à
Montréal et 153 à Québec ?

Nous
l'avons déjà dit, c'est l'autorité religieuse
qui est chargée de la tenue des registres d'état
civil du Québec. On note d'ailleurs parfois quelques bizarreries.
Par exemple, l'identité des parents de la mariée
sur l'acte de mariage est différente de celle donnée
sur un certificat du même mariage ! Cela s'est passé
en 1947.
Par ailleurs, et tout en faisant abstraction des accents, nous
avons relevé neuf différentes façons d'orthographier
le nom de la même personne ! Il s'agit de Mathilde Defayette,
l'épouse de François-Victor Déom. Nous sommes
pourtant déjà dans le dernier tiers du 19ème
siècle. Si le nom est orthographié quinze fois Defayette,
on trouve par ailleurs des Despayette, De Fayette, Desfayettes,
Desfayette, de Faillette, de Lafeuillette, Fayet et Défaillette
! Et lorsque le fils de Mathilde se marie en 1946, il est appelé
Victor Déom, dit Lafeuillette...

Albert
est veuf à 38 ans. Remarié, il divorce alors qu'il
vient de célébrer son 73ème anniversaire.
Deux ans plus tard, il unit son destin à celui de Catherine
!
Jean-Paul,
né à Thibessart au 18ème siècle,
se marie quatre fois étant, bien entendu, devenu veuf à
trois reprises. Seules ses deux premières épouses
lui donnent des enfants : quatre d'Anne-Marie suivis par deux
autres d'Anne-Catherine. Jean-Paul a 65 ans quand il épouse
en 1836, Marie-Françoise, sa cadette de 24 ans.

Jean-Baptiste,
né en 1808 à Suxy, est bien décidé
à prendre femme. La promise est Marie-Joseph Henrion d'Orgeo.
Monsieur le maire de Suxy, comme le veut la loi, prépare
les bans qui, bien qu'inscrits dans les registres, ne seront jamais
publiés. Le maire a, en effet, ajouté l'annotation
suivante :
"La
présente publication n'a pas eu lieu attendu que l'une
des parties, la nommée Marie-Joseph Henrion, a déclaré
ne pas être en sentiment d'être mariée au dit
Déom."
Mais
il en faut bien davantage pour démonter notre Jean-Baptiste.
Quelques mois plus tard, il se marie avec Joséphine Absin
de Les-Fossés...

À
présent, nous vous proposons un petit problème.
Nous avons retrouvé un contrat de mariage entre "Henri
Joseph Deome, garçon majeur cultivateur de Cousteumont
né du mariage de Nicolas Deome avec Marie Thérèse
Maur, et Marie Thérèse Lafontaine, cultivatrice
majeure domiciliée aux Fossés, née du mariage
de Jean Lafontaine avec Marguerite Adam". Ce contrat
est signé par les deux parties le 16 novembre 1815 chez
le notaire Ponce Orban de Neufchâteau
[450]
.
Un mois plus tard, le 15 décembre 1815
[451]
, nous trouvons un autre contrat de
mariage établi entre "Henri Joseph Deom, garçon
majeur, cultivateur domicilié à Cousteumont, né
du mariage de Nicolas Deom avec Marie Thérèse Maure,
d'une part, et Marie Catherine Balbeur, fille mineure
[452]
née du mariage de Salomon
Balbeur avec Anne Joseph Honechenerer, d'autre part."
Sachant que :
- Les deux
documents sont respectivement signés "henrie
Joseph Deome et henrie Joseph Deom". L'écriture
est la même !
- Sur les
neuf enfants qu'ont eu Nicolas Déom et Marie-Thérèse
Maur, un seul avait été appelé Henri-Joseph.
- À
notre connaissance, Jean Lafontaine et Marguerite Adam n'ont
eu qu'une seule fille prénommée Marie-Thérèse.
Cette dernière épouse d'ailleurs un certain Etienne
Lambert le 8 novembre 1815 à Les-Fossés.
- Une Marie-Thérèse
Lafontaine épouse, le 12 mai 1817 toujours à Les-Fossés,
un dénommé Jacques Mergeay. Mais elle est la fille
de Nicolas Lafontaine et de Marie-Thérèse Noël.
- Nous n'avons
jamais trouvé ni la publication des bans, ni à
plus forte raison l'acte de mariage entre Henri-Joseph Déom
et Marie-Thérèse Lafontaine. Par contre, les bans
du mariage Deom - Balbeur ont bien été proclamés
les 10 et 17 décembre et le mariage a été
célébré le 20 décembre 1815 à
Assenois.
Voilà,
il ne vous reste plus qu'à trouver l'erreur...

Célestine
de Neufchâteau et Jeanne-Marguerite de Behême ont
été mariées trois fois et ont été
veuves trois fois.

Nicolas
a 64 ans et il est veuf depuis six ans. Il épouse alors
Marie-Modestine, sa cadette de 28 ans, qui lui donnera encore
deux enfants. Lorsque naît le dernier, Nicolas a 67 ans
!

On
dit qu'il faut être mûr avant de se marier. C'était
le cas d'Omer, qui fêtait ses 57 ans quelques jours après
son mariage et qui pourtant... divorçait deux ans et demi
plus tard !

D'autres
ont également beaucoup réfléchi avant de
se marier :
- Joseph
Déom et Marie-Amélie ont déjà quatre
enfants quand ils se présentent devant Monsieur le maire.
Deux autres bambins compléteront encore la famille.
- Bernard
Déom et Denise ont cinq enfants et lorsqu'ils régularisent
leur situation l'aîné a 23 ans et la benjamine
en a 3 !
- Marie-Joséphine
Déom, née au début du 19ème siècle,
est six fois fille-mère ! Alors seulement elle se décide
à se marier...

D'autres
encore ont choisi :
- Une femme
dont l'anniversaire coïncide avec le leur, comme Jean-Marie
et Édith,
- De se
marier le jour même de leur anniversaire, comme Berthe,
Léonne, Rolland, Marie-Henriette, Jenny, Jean, Léo
et Vincent.

Si
notre nom a disparu des registres d'état civil de Harzy
près de Wardin, c'est pour la bonne raison que sur les
huit enfants que le couple Déom - Goffinet a élevés,
seule Catherine s'est décidée à fonder une
famille.

- Veuf d'Yvette,
Adelard Déom épouse Liliane, la sœur de sa
première épouse.
- Marie
était très satisfaite de son Déom : veuve
de Lionel, elle épouse Albert, le frère.
- Thomas
avait épousé Marie-Jeanne Déom. Lorsque
cette dernière décède, Thomas obtient la
main de Marie-Joseph, la sœur cadette de Marie-Jeanne.
- Scénario
identique avec Noël, un vitrier suisse installé
en Wallonie, qui épouse Bertha Déom, la sœur
cadette de sa première épouse Camille.

Antoine
épouse Joséphine Leclerc en 1854. L'année
suivante, Isidore le frère d'Antoine, se marie avec Catherine,
la sœur de Joséphine ! Isidore avait certainement
eu de bons tuyaux de son frère. À moins que Joséphine
ait fait des confidences à Catherine ?
Les mêmes scénarios se renouvellent :
- À
Paris en 1864 et 1867 quand les frères Jean-François
et François Chagot, de souche lorraine, épousent
les deux sœurs, Marie-Joseph et Marie-Odile Déom,
originaires de Nivelet.
- À
Bertrix en 1988 et 1994 quand les deux sœurs Annick et
Vinciane Déom épousent les deux frères
Stéphane et Alain Perreaux.

Encore un
peu mieux. François Déom épouse Marie-Antoinette
Noël à Assenois en 1840. Ce mariage donne des idées
au célibataire endurci qu'est Pierre, le frère aîné
de François. En 1848 à Assenois, Pierre épouse
en effet… Marie-Antoinette Noël, la sœur cadette
de la femme de son frère !

Beaucoup
plus récemment, à Poseyville aux U.S.A., les sœurs,
Margaret et Patricia Deom, ont dit "Yes" à
Thomas Engelking et à Bill Flynn. Cela s'est passé
le même jour et dans la même église.

Mieux
encore. Josiane a uni son destin à celui de Bruno et Anna
à celui de Joseph.
Et alors ? Eh bien, cela s'est passé le même jour
et dans un même lieu !
Et alors ? Eh bien, Josiane est la sœur de Joseph et Bruno
est le frère d'Anna !

Encore
plus fort !
Cela se passe de nouveau aux États-Unis. Mary-Rose Deom
épouse Joseph Dauby en 1896. En 1902, Victoria Deom se
marie avec John Dauby et en 1905, c'est au tour de Pauline Deom
de convoler en justes noces avec Frank Dauby.
Sachez que Mary, Victoria et Pauline sont sœurs et que Joseph
Dauby est le père de John et de Frank !
Quand tous ces mariages sont célébrés :
- Mary-Rose
est devenue la belle-mère de ses deux sœurs.
- Ces deux
dernières deviennent belles-sœurs.
- Les deux
frères, John et Franck, sont également beaux-frères.
- Joseph
est le beau-père de ses deux belles-sœurs.
Ah ces Américains !

Marie-Joseph
Marchal, la fille de Marie-Françoise Déom d'Arville,
a épousé Henri Dieudonné Verlaine, le cousin
du père de Paul Verlaine. La famille du poète, né
à Metz, est originaire de Bertrix mais les racines profondes
sont à Verlaine, petit village près de Neufchâteau.
Quand on vous dit que nous sommes tous cousins !
Julienne Déome de Gennevaux était l'épouse
de Henry-Joseph La Fontaine et Claude François Racine était
le mari de Marie-Joseph Déom de Virton. Il ne reste plus
qu'à démontrer que Claude François et Henry-Joseph
sont les cousins des deux poètes...

Il
arrive parfois que l'enfant tant désiré se fasse
attendre. Mais la joie n'est que plus grande encore quand il a
fallu patienter quelques années pour devenir papa et maman.
Cela a duré :
-
10 ans pour Victor et Denise,
- 12 ans pour Léon et Micheline,
- 14 ans pour Gérard et Brigitte,
- 15 ans pour Gustave et Simone,
- 17 ans pour Maurice et Françoise et pour Jacques et
Danielle !

Marie-Jeanne
Deum est née à Rulles le 12 janvier 1749. Elle vient
tout juste d'avoir 16 ans quand elle épouse Jacob Perleau
à Rulles le 17 février 1765 !
Après de minutieuses recherches et vérifications,
il semble bien qu'il ait fallu attendre presque 24 ans pour que
cette même Marie-Jeanne soit enfin maman pour la première
fois ! Marie-Victorine Perleau naît en effet à Rulles
le 7 juin 1789. Les performances énumérées
dans le paragraphe précédent seraient donc pulvérisées
!
Le couple ne semble pas avoir quitté le pays où
Jacob et Marie-Jeanne sont plusieurs fois parrain et marraine
au cours de ces nombreuses années.
En
1803, la veuve Perleau porte plainte car elle avait, avec son
défunt mari, dépensé beaucoup d'argent pour
venir en aide aux religieux de l'abbaye d'Orval, obligés
de quitter leur retraite incendiée par les troupes françaises
en 1793. Les religieux se sont alors établis au Luxembourg
puis à leur prieuré de Conques et le couple s'est
beaucoup occupé, avec voiture et chevaux, du transport
des effets des moines qui sont aussi "passés et
repassés à Rulle chez la citoienne". Marie-Jeanne
Deum qui leur a fourni 112 moutons, de la laine ainsi qu'une pièce
d'eau de vie pour lesquels elle demande respectivement 940, 105
et 57 florins.
La plaignante demande aussi 1 247 florins, soit 2 079
francs en argent de France pour les frais de transport
[453]
. Rien de tout cela ne lui a été
payé...
Deux ans plus tard, Marie-Jeanne épouse Rigobert Herbulot
de Pouru-St-Rémy, près de Sedan, qui a vingt ans
de moins qu'elle...

Si
Marie-Jeanne avait bien vécu seize printemps avant de se
marier, sa sœur Marie-Catherine, n'avait que 15 ans et 9
mois lorsqu'elle épousa Jean-Baptiste Jacob à Rulles
le 11 avril 1751 !

Jean-Joseph
Lemaire était dans sa 55ème année
lorsqu'il épousa Marie-Thérèse Déom
de Vesqueville qui venait d'avoir 19 ans ! De cette union naquirent
Jean-Joseph et Auguste.

En
1990 et en premières noces, s'il vous plaît, Céline
épouse Marc, 43 ans. Le couple a les honneurs de la télévision
belge. Il est vrai que Céline Déom vient de fêter
ses... 85 printemps !

Nous
connaissons les dates précises de plus de 1 800 mariages
avec un "Deum" dans le rôle du marié ou
de la mariée. Si on établit un classement selon
l'âge croissant de ces tout jeunes mariés, on aperçoit,
menant le peloton, un important groupe de filles. Il faut aller
à la 36ème place pour trouver le premier
garçon. Il s'agit de Jean-Joseph Deum qui a 18 ans et demi
quand il se marie à Heyd le 24 mai 1819. À l'autre
bout de ce classement, on trouve, mais loin, très loin
derrière tout le monde, Céline Déom dont
il a déjà été question.
Sur les 138 "Deum" qui avaient plus de 40 ans le jour
de leur mariage ou de leur remariage, nous trouvons seulement
38 filles ! Si 42 de ces célibataires de "longue durée"
ont vécu au 19ème siècle, il faut
encore remarquer qu'on en compte 35 dans la première moitié
du 20ème et 49 après 1950.
Mais
à quel âge, en général, nous marions-nous
? Nous allons faire une distinction entre garçons et filles
et faire un bilan sur trois siècles : 18ème,
19ème et 20ème en divisant
même ce dernier en deux parties égales. Nous ne prenons
pas en considération le 17ème siècle,
car seules douze dates de mariages nous sont connues et il est
impossible de tirer des conclusions à partir de si peu
de données.
Il
faut encore noter qu'à partir de 1792, c'est la date du
mariage civil qui est pris en compte.
Quelles sont les caractéristiques de ces mariages ?
1)
Quel est l'âge du marié ou de la mariée
?

Âge
moyen au moment du mariage
2)
Quelle date choisit-on ?
Le quantième du mois le plus prisé est le 22 et
le 24, suivis de très près par le 19 et le 20. Par
contre, le 29 est le jour le moins apprécié. Même
le 13 a une meilleure cote !
C'est incontestablement au cours du mois de mai que le plus de
mariages ont été célébrés,
devant avril et juillet et février. Les jours de l'année
arrivant en tête, ex æquo, avec treize unions proclamées
sont les 19 avril, 26 avril et 15 mai !
Mais les choses sont en train de changer comme le montrent les
statistiques suivantes (en % du nombre de mariages célébrés)
:

Ce
tableau donne le nombre d'unions célébrées
au cours de chaque mois pour un total de 100 mariages proclamés
durant la période considérée.
Par exemple : une moyenne de 6,34 mariages ont eu lieu
en juillet dans la période allant de 1901 à 1950.
Nous obtenons le graphique :

Quand
allons-nous nous marier ?
Malgré
une moyenne annuelle ramenée à 28 jours un quart,
le mois de février était le préféré
de nos ancêtres du 18ème siècle.
Nous constatons aussi que mars et décembre n'ont vraiment
jamais été bien cotés alors que durant un
siècle et demi, de 1800 à 1950 environ, c'est mai
qui a eu la meilleure "fréquentation".
Enfin, on s'aperçoit que les mois de l'été,
juin, juillet, août et septembre ont, depuis quelques années,
les faveurs des fiancés de cette fin de millénaire.
Auparavant, cette période était plutôt consacrée
aux travaux des champs !
C'est après la Seconde Guerre mondiale que le plus grand
nombre de mariages ont été célébrés
: seulement 7 en 1943 et 4 en 1944 puis 20 en 1945, 18 en 1946,
22 en 1947, 20 en 1948, 14 en 1949, 22 en 1950, 21 en 1951 et
26 en 1952, record à battre. Par la suite on passe au-dessous
des 20, sauf en 1963 (20) et 1975 (23). Depuis, leur nombre décroît
et entre 1993 et 1999 on a proclamé, en moyenne, environ
huit mariages par an !
Quelques
nouvelles nécrologiques
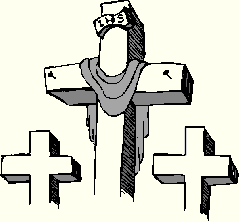
Jean-Guillaume
Déom qui fut tisserand à Léglise en 1847,
s'installe à Paris avec son épouse et ses cinq enfants.
Il exerce alors le métier de forgeron puis de jardinier.
En quelques mois de l'année 1875, il perd sa femme et ses
deux filles pourtant déjà adultes. Nous n'avons
jamais retrouvé la trace de Jean-Guillaume, ni celle de
ses deux garçons.
Au passage, soulignons la polyvalence de cet homme qui fut aussi
cultivateur en 1857 à Léglise.

Né
en 1824 à Rossignol en Belgique, Joseph Déome est
retrouvé mort sur la place du parvis de Notre Dame à
Paris le 6 janvier 1877.

Catherine-Joseph
Déom, neuf ans, meurt à Cousteumont le 23 nivôse
de l'an dix de la République
[454]
. L'acte de décès porte
la mention "cultivateure" !

Louis-Joseph
Déom d'Orgeo et son épouse, Marie-Augustine Urbain,
ont eu dix enfants ! Les trois aînés meurent du croup
en deux jours, les 14 et 15 avril 1863. Ils avaient alors trois,
deux et un ans !

Dans
un registre de décès de la paroisse de Longlier
- Neufchâteau, on peut lire : "Le 21 juillet 1791
à quatre heures du matin est morte Marie-Jeanne Deom épouse
a Jean Baptiste Rolland, pauvre homme..."

Les
six enfants que Marie-Élisabeth Pigeot avait donnés
à Jean-Nicolas Déom, domestique à Marbay,
décèdent les uns après les autres. Un garçon
et une fille meurent en 1863. Entre le 12 mars 1879 et le 8 avril
de la même année, le couple perd trois filles et
un autre garçon ! Ce garçon, Jacques-Joseph, le
plus âgé de tous, avait tout juste atteint la vingtaine...

Des
dix enfants qui naissent à Ferrières au début
du 19ème siècle d'Anne Élisabeth
Corbelle et de Joseph Deum, seuls deux filles et un garçon
survivent. Voilà qui explique, en partie, la disparition
de notre nom de cette localité où notre famille
était restée ancrée durant deux cents ans.

Honoré-Joseph
naît à Vièrves le 3 février 1880 à
11 heures. Un autre Honoré-Joseph naît à Vièrves
le 3 février 1880 à 12 heures. Les parents, Désiré
Déom et Marie-Joseph Piraux, ne sont cependant pas heureux
longtemps car les jumeaux décèdent les 9 et 10 février
de la même année.

Eugène
Philippe Déom est cultivateur au début du 20ème
siècle à Baerendorf en Alsace. Marie-Angélique
Fiegel, sa femme, lui donne six enfants, trois garçons
et trois filles. Si ces dernières laissent une descendance,
les trois garçons sont par contre décédés.
Deux sont morts de maladie à l'âge de 10 et 15 ans
alors que le troisième se tue en faisant une chute à
bicyclette. Il avait alors 18 ans !

Quelques
membres de notre famille ont quitté ce monde le jour même
de leur anniversaire. C'est le cas d'Englebert Déom décédé
à Mellier en 1842, le jour de ses 62 ans, d'Albert Déom
mort en 1972 à Neufmanil à l'âge de 71 ans,
d'Omer Déom qui s'est éteint le jour de ses 72 ans
à Jambes en 1977, de Raymond Deum qui devait fêter
son 62ème anniversaire à Stavelot en
1985, d'Ernest Déom mort à Marche en 1988 âgé
de 82 ans et d'Yvonne Déom qui s'est éteinte à
83 ans en 1990 à Agimont.

S'il
est arrivé 21 fois que deux membres de notre famille meurent
le même jour en des endroits généralement
différents, rappelons que durant la Première Guerre
mondiale le père, Édouard Déom, et ses deux
fils, Joseph et Louis, sont morts fusillés par les Allemands
le 22 août 1914 à Tintigny. Gravement blessé
le même jour, Henri, le frère d'Édouard, fut
abandonné au bord de la route et personne ne retrouva jamais
son corps.
Dans des conditions moins tragiques, le 14 septembre 1954 vit
mourir Marie-Eugénie Déom, 82 ans, Pauline Deom,
68 ans, et Firmin Déom, 69 ans, respectivement à
Habay (B), Leopold (U.S.A.) et Neufchâteau (B).

Il
nous est souvent arrivé ici de parler de François-Xavier
Déom parti de Virton pour Montréal où il
épouse Anne Lorge dès 1859. Le couple a neuf enfants
dont sept décèdent dans l'année qui suit
leur naissance. François-Victor, le frère du précédent,
ne tarde pas à rejoindre également la "Belle
Province" où il exerce la profession de confiseur,
métier qu'il avait appris à Mézières
(France)
[455]
. François-Victor Déom
épouse Mathilde Defayette à Montréal le 20
mai 1862. C'est en accouchant de son quatorzième enfant
que Mathilde décède le 25 mai 1883. Seulement deux
filles (sur neuf) et un garçon (sur cinq) survivent. Les
autres sont morts, le plus âgé n'ayant pu fêter
que douze anniversaires ! Le bilan est terrible : les deux couples
ont perdu 18 de leurs 23 enfants !

Au
Québec lorsque vient au monde un enfant mort-né,
dans le registre des décès on écrit souvent
: "Déom anonyme".

Avant
de faire un bilan concernant les décès, précisons
d'abord que nous n'avons pas du tout la prétention d'établir
de statistiques sur la durée de vie des gens ayant vécu
au 18ème ou au 19ème siècle.
Cette remarque concerne aussi les bilans réalisés
précédemment sur les naissances et sur les mariages.
Nous faisons ici, seulement le compte-rendu du constat fait au
niveau de notre famille.
Ceci étant précisé, revenons à nos
décès pour remarquer tout d'abord qu'il serait vain
de vouloir tirer des conclusions avant 1750. Jusqu'alors les inhumations
ne sont pas systématiquement mentionnées dans les
registres de sépultures, notamment celles des enfants de
moins de dix ans.
Le tableau suivant donne le nombre des décès connus
par rapport au nombre de personnes nées dans une période
donnée.
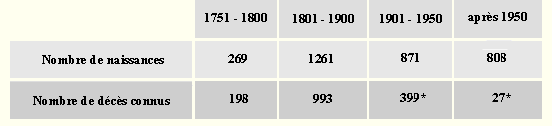
*
= séries en cours...
Seuls 198 décès sur les 269 "Deum" nés
dans la seconde moitié du 18ème siècle,
nous sont donc connus. Au 19ème siècle,
nous en avons 993 sur 1261, soit respectivement 73,6% et 78,7%.
Que sont donc devenues les autres personnes ?
Il
est certain que des prêtres du 18ème siècle
ont parfois oublié de transcrire quelques enterrements
dans leurs registres. Rappelez-vous qu'à Léglise
on ne relève aucun décès entre le 31 décembre
1774 et le 31 décembre 1778. Mais cette négligence
ne concerne certainement plus le 19ème siècle.
Alors ? Eh bien, certains décès ont tout simplement
échappé à notre ratissage pour la bonne raison
qu'il existe une infinité d'endroits pour mourir ! Rien
n'empêche, en effet, une personne née à Nivelet,
d'aller finir ses jours à Amsterdam, par exemple ! Comment
retrouver ce fait avec les moyens dont nous disposons ?
Et
si la Belgique ne mesure que 30 000 km2, il s'y trouve, malgré
tout, de nombreuses communes, même après les fusions
de 1976 ! Et puis, notre famille est aussi installée en
France, en Allemagne, aux États-Unis et au Canada où
le problème est encore beaucoup plus ardu.

Le
tableau, ci-après, donne les caractéristiques de
notre inventaire.
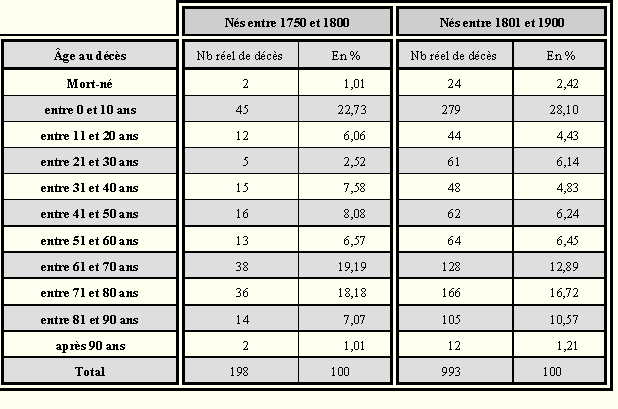
Destin du "Deum" né entre 1750 et 1900
L'importante
mortalité infantile est principalement due aux épidémies
et aux famines. Des organismes spécialisés donnent
un mort sur quatre naissances au 18ème siècle
[456]
. Nous sommes donc très loin du compte.
Le
tableau, ci-dessous, exprime, selon nos données, l'âge
moyen de nos aïeux au moment de leur mort.
|
"Deum"
nés entre 1750 et 1800
|
"Deum"
nés entre 1801 et 1900
|
| Filles |
47
ans et 2 mois
|
40
ans et 50 mois
|
| Garçons |
44
ans et 1 mois
|
44
ans et 1 mois
|
Âge
moyen au moment du décès
Le
constat fait précédemment sur les décès
"oubliés" se confirme ici. Entre 1750 et 1800,
l'espérance de vie atteignait à peine les trente
ans. Or nous constatons que nos aïeux de l'époque
mouraient, en moyenne, vers 45 ans !
Autre remarque : contrairement aux statistiques officielles, les
garçons "Deum" vivent donc plus longtemps que
les filles. Selon ces études
[457]
, l'espérance de vie à
la naissance était d'environ 35 ans au début du
19ème siècle pour atteindre 45 ans à
la fin du même siècle.
Si les chiffres, ci-dessus, semblent flatteurs pour notre famille
au 18ème siècle, ceux du 19ème
se situent, par contre, dans les normes pour nos femmes et sont
assez avantageux pour nos hommes.
Par ailleurs, si la durée de vie moyenne était bien
faible, cela n'empêcha pas certains d'atteindre un âge
très respectable. C'est ainsi que :
- Anne,
Jeanne et Englebert, nés respectivement en 1691 à
Gennevaux, en 1678 à Habaru et en 1658 à Nivelet,
décédèrent âgés respectivement
de 81, 84 et 84 ans et demi.
- Cinq "Deum"
nés au 18ème siècle ont dépassé
les 90 ans : Jeanne-Marie de Lavaux (90), Marie-Jeanne épouse
Delva de Thibessart (90), Jean de Gennevaux époux de
Suzanne Fineuse (91), Marie-Catherine de Louftémont (91)
et Henri-Joseph époux de Marie-Jeanne Adnet de Tintigny
(92 ½).
- 139 "Deum"
nés au 19ème siècle sont morts
âgés de plus de 80 ans, 16 d'entre eux ont même
passé le cap des 90 ans ! Parmi eux, Mary-Bertha Deom,
épouse de Georges Alvey, née en 1893 à
Leopold, en Indiana, avait 99 ans et 8 mois à son décès.
C'est
le record à battre au moment où nous écrivons
ces lignes !
Enfin, il est bien évidemment trop tôt pour faire
un bilan sur le dernier siècle de ce millénaire.
Précisons tout de même que durant la première
moitié du siècle on compte, en moyenne, un mort-né
toutes les 43 naissances alors qu'après 1950, il n'y en
a plus qu'un sur 157 naissances, le dernier cas s'étant
présenté en 1964 au Québec.
À notre connaissance, seulement 399 des 871 personnes,
nées entre 1901 et 1950, et 27 des 808 nées entre
1950 et nos jours, sont actuellement décédées.
Pour les autres l'aventure se poursuit... Les membres de notre
famille vont évidemment suivre la tendance générale
et vivre de plus en plus longtemps. L'espérance de vie
est en progression spectaculaire, surtout depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale. Les hommes et les femmes qui venaient
au monde au début de ce siècle avaient une espérance
de vie de 45 ans et demi pour les uns et de 48 ans et 8 mois pour
les autres.
Le tableau, ci-dessous, montre l'évolution de l'espérance
de vie des Français depuis 1946
[458]
.
La supériorité des femmes sur les hommes est éclatante
!
|
Année
|
Hommes
|
Femmes
|
|
1946
|
59,9
|
65,2
|
|
1956
|
65,2
|
71,7
|
|
1966
|
67,8
|
75,2
|
|
1976
|
69,2
|
77,2
|
|
1986
|
71,5
|
79,7
|
|
1996
|
74,0
|
82,0
|
Les
spécialistes prévoient qu'en l'an 2020, l'espérance
de vie sera de 78,4 ans pour les hommes et de 86,5 ans pour les
femmes !
Plusieurs facteurs influencent cette formidable augmentation :
progrès en matière d'hygiène, maîtrise
accrue, puis presque parfaite dans la lutte contre les maladies
infectieuses, absence de conflit mondial depuis un demi-siècle...
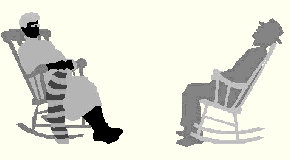
Voilà
dix ans maintenant que les recherches sur notre famille ont été
entreprises et menées quasi quotidiennement. Environ 1 900
lettres ont été écrites apportant une réponse
dans 90% des cas et pas moins de 65 000 kilomètres
ont été parcourus en voiture ! Ainsi, les registres
d'environ 400 localités disséminées en Belgique,
en France, au Grand-Duché de Luxembourg, en Allemagne et
au Québec ont été compulsés. Des centres
d'archives belges, français, allemands, luxembourgeois
et canadiens ont été fréquentés, certains
avec une fidélité débordante... Mais l'expérience
vécue a été passionnante.
Tout
le monde a pu s'en rendre compte : la généalogie
est très à la mode actuellement. Les journaux et
la télévision en parlent très souvent contribuant
ainsi à augmenter encore l'engouement pour cette science
dont le nombre des adeptes croît chaque jour un peu plus.
Pourquoi cette soudaine passion ? Il est, dit-on, "difficile
de savoir qui on est si l'on ne sait pas d'où l'on vient".
L'éclatement
des familles, le déracinement de plus en plus important
et la nostalgie du temps passé en sont certainement les
principales causes. Finies les longues veillées des soirées
d'hiver pendant lesquelles se transmettait la mémoire familiale.
On raconte que certaines peuplades se souviennent de huit générations
alors que nous n'avons plus en mémoire que les deux dernières
et encore... Remarquons aussi que le nombre toujours plus élevé
des retraités en bonne santé, ajoute encore une
vague supplémentaire de chercheurs.
Jusqu'à
quelle époque est-il possible de connaître sa généalogie
? Voilà une des questions que se posent de nombreuses personnes
avant même d'avoir commencé leurs recherches. Nous
l'avons dit : les registres paroissiaux existent, en moyenne,
depuis la fin du 17ème siècle. Mais nos
investigations peuvent, hélas, être brusquement interrompues,
parfois dès le 19ème siècle !
Les dégâts causés par les guerres, par le
feu, par l'eau mais aussi des négligences sont à
l'origine de la plupart des lacunes. Alors, il ne nous reste pratiquement
plus que les actes notariés, souvent mieux conservés
mais où les filiations sont généralement
bien plus difficiles à établir, pour espérer
connaître un peu plus l'histoire de notre famille !
Le généalogiste débutant est immédiatement
confronté à un double problème : où
et comment commencer les démarches ?
Il
faut déjà savoir qu'en Lorraine les actes de baptême,
de mariage et de décès ont en principe et depuis
toujours, été établis en double exemplaire.
La plupart des prêtres faisaient effectivement des duplicata
car une copie devait obligatoirement être déposée
tous les ans au greffe de la juridiction ! En Ardenne belge, la
rédaction du second exemplaire n'a été rendue
obligatoire qu'en 1766.
De nos jours, un exemplaire est conservé à la mairie
[459]
du lieu alors que le second est archivé
dans des centres spécialement conçus pour cela après
avoir transité par le tribunal de 1ère
instance du secteur où il est resté durant cent
ans. Chaque région allemande, chaque province belge, chaque
département français est doté au moins d'un
de ces centres
[460]
. Le Grand-Duché de Luxembourg
en possède un dans sa capitale et nous avons effectué
des recherches aux Archives Nationales du Québec à
Montréal. Dans ces lieux se trouvent donc les registres
paroissiaux de l'Ancien Régime ainsi que les registres
d'état civil depuis 1792 sauf ceux des cent dernières
années encore conservés au tribunal.
Vous pourrez donc réaliser vos recherches dans ces centres
à condition, bien entendu, de connaître la partie
la plus récente de votre filiation. La mémoire familiale
étant de plus en plus défaillante, il vous faudra
peut-être commencer vos démarches dans les mairies.
Ces dernières sont tenues à vous fournir des photocopies
des actes d'état civil concernant votre filiation directe
: père, mère, grands-pères, grands-mères,
… Mais vous devez être en possession d'une autorisation
délivrée par le président du tribunal de
1ère instance pour pouvoir faire des recherches
sur vos collatéraux. Ce laissez-passer, qui est de plus
en plus difficile à obtenir, ouvre en principe les portes
de toutes les mairies de la juridiction concernée. Vous
aurez alors accès aux registres de moins de cent ans
[461]
.
Depuis une dizaine d'années les administrations communales
sont régulièrement sollicitées et vous ne
trouverez qu'exceptionnellement un employé acceptant de
faire gracieusement vos recherches.
Si vous êtes presque toujours bien reçu dans les
petites communes, dans les grandes vous avez toujours l'impression
de déranger. En Belgique, certains bourgmestres ont même
choisi la solution radicale interdisant purement et simplement
l'accès aux registres à toute personne étrangère
au service. C'est un employé des lieux qui est alors chargé
d'effectuer les recherches selon vos directives ce qui entraînera
évidemment des dépenses supplémentaires !
En d'autres lieux, vous êtes autorisé à compulser
vous-même les registres à condition de verser une
redevance de 1 000 francs belges, soit environ 25 €,
par heure de recherches. Lorsque après avoir hésité
vous finissez par accepter le marché, ne soyez pas étonné
d'entendre le secrétaire communal vous dire que cela n'est
pas possible aujourd'hui, aucun membre de son personnel n'étant
disponible pour vous surveiller ! En clair, dans ces communes
le généalogiste est devenu indésirable.
Il faut bien reconnaître que ces réactions ont très
certainement été provoquées par le comportement
de chercheurs peu scrupuleux. N'oublions pas que les élus
locaux sont responsables et de la bonne marche de leur administration
et de la bonne conservation des précieux registres.
Mais n'y a-t-il vraiment pas une autre solution ?
Si
dans les petites communes allemandes on vous reçoit comme
chez nous, il en va tout autrement lorsque vous débarquez
dans une grande ville. À Bonn, par exemple, après
avoir vérifié votre identité, vous pouvez
obtenir tous les renseignements que vous voulez. Y compris ceux
de moins de cent ans. L'employé ne vous remet pas le registre
mais vous donne tous les détails contenus dans l'acte qu'il
a sous les yeux à condition de payer sept Marks
[462]
pour chaque registre que vous
faites déplacer ! Comme Bonn est une grande ville et que
très peu d'habitants y portent notre nom, un registre contient,
tout au plus, un seul acte concernant notre famille. L'expérience
faite prouve que 150 € sont très rapidement dépensés
! En échange, vous recevez une "Quittung"
[463]
en bonne et due forme...
Parvenu
à la troisième ou quatrième génération
de votre arbre généalogique, vous voilà donc
arrivé dans un centre d'archives où vos recherches
vont se poursuivre plus sereinement. Ces lieux qui étaient
jadis des havres de tranquillité sont, depuis quelques
années, devenus de véritables ruches souvent trop
exiguës. Nos investigations nous ont fait découvrir
le "Nordrhein - Westfälisches Personenstandsarchiv
Rheinland" situé à Brühl, près
de Cologne. L'endroit est charmant. Mais il faut prendre rendez-vous
longtemps à l'avance, car quinze toutes petites places
seulement sont susceptibles d'accueillir les chercheurs. Et dire
que le secteur couvert par ce centre totalise environ quinze millions
d'habitants !
Chez nous, on a augmenté le nombre des employés
et on a souvent agrandi les locaux. De nouveaux centres ont même
vu le jour ! Partout, on est en train de microfilmer les registres
afin de sauvegarder les originaux de plus en plus sollicités.
Les salles de lecture sont donc équipées d'appareils
permettant de consulter et de photocopier les actes
[464]
.
Nous avons effectué des recherches dans cinq pays. Si en
France, au Grand-Duché de Luxembourg et au Québec,
l'accès aux centres est gratuit, en Allemagne la journée
coûte 4 Marks (environ 2 €). Une carte d'abonnement
annuelle payée six cents francs belges (14,9 €) permet
d'accéder aux 16 centres du royaume de Belgique. Partout,
on trouve des employés serviables susceptibles de vous
conseiller et même de vous aider ; selon notre expérience,
deux centres se distinguent toutefois des autres. Ce sont les
Archives de l'État d'Arlon pour l'excellente ambiance qui
y règne et les Archives Nationales du Québec de
Montréal pour les facilités données aux chercheurs
: tout le monde a directement accès aux microfilms dans
des salles ouvertes au public du lundi au mercredi de 8 h 30 à
21 h 30 et du jeudi au... dimanche de 9 h à 17 h !
N'oublions
pas que les registres religieux restent une source de renseignements
qui peut s'avérer très utile. Les évêchés
allemands se sont d'ailleurs organisés afin de pouvoir
accueillir les généalogistes. Les demandes étant
de plus en plus nombreuses, le système est aussi devenu
payant.
Nous avons récemment écrit à l'évêché
de Bamberg, en Bavière, afin de tenter d'obtenir une copie
de l'acte de baptême de Jeanne Déom. Lorsque cette
dernière décède, le 19 avril 1859 à
Chalais dans le département français de l'Indre,
on la dit âgée de 55 ans et née à Nuremberg,
Bavière. Elle était donc venue au monde en 1804
avec une erreur probable de plus ou moins un an.
C'est avec ces précisions que notre requête prit
la direction de l'évêché allemand
[465]
. La recherche resta vaine, mais il
n'empêche qu'une demi-heure de travail, soit 40 Marks
[466]
payables par chèque, nous fut
facturée !
Aucune
démarche n'a été directement entreprise aux
États-Unis, mais les renseignements que nous avons tenté
d'obtenir par correspondance permettent de dire que, là
aussi, tout se monnaie. Les centres d'archives délivrent
des photocopies valant au moins, 5 dollars, soit environ 5 €,
payables d'avance. Il faut que vous puissiez donner la date et
le lieu exact et même dans ce cas votre demande risque de
revenir avec la mention : "No record found."
[467]
Comme votre paiement est malgré
tout encaissé à chaque demande, vous êtes
rapidement écœuré et vous abandonnez vos démarches.
Certains
de nos correspondants américains
[468]
prétendent cependant que si l'on
se rend sur place, les choses se présentent de manière
bien plus conviviale.
Notez
encore qu'il existe un moyen de faire de la généalogie
en évitant de lointains et coûteux voyages. L'église
de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours (Les Mormons)
a microfilmé un très impressionnant nombre de registres
d'état civil dans de nombreux pays
[469]
. Pour la modique somme de 4,5 €,
elle met rapidement à votre disposition dans un de ses
locaux, le microfilm que vous avez été choisir dans
leur catalogue.
Par exemple, il vous sera possible de consulter à Metz
[470]
, une copie des registres rédigés
au siècle dernier au Perry County, Indiana (U.S.A.).

Certains
registres sont difficiles à déchiffrer. C'est vrai,
mais contrairement à ce que l'on peut croire, ce ne sont
pas forcément les plus anciens. En d'autres occasions vous
pouvez avoir à lire des actes écrits en latin ou
en allemand parfois gothique ce qui complique encore l'affaire.
Il
faut bien reconnaître que le préposé aux écritures
ne peut être considéré comme un véritable
artiste qu'en de très rares occasions ! Le "Deom
Georg", ci-après, est pourtant extrait d'un acte
de mariage célébré sous l'annexion allemande
à Loudrefing (Moselle) en 1902.

Mais le secrétaire de mairie du 20ème siècle
fait encore quelques erreurs ici ou là. Prenons, par exemple,
l'acte de naissance d'Yvette Déom. Émile Déom
est venu déclarer la naissance. Il signe l'acte dans lequel
on peut lire que "dans sa demeure est née le 9
juin 1935 Yvette, de lui comparant et d'Amélie Déom".
Il faudra un jugement du tribunal de 1ère instance
pour supprimer la mention "de lui comparant".
Précisons qu'Amélie Déom est la fille d'Émile
Déom !
Ailleurs
naissent une "Marie-Catherine Dehomme et une Marie-Philomène
Déom de sexe masculin" ! Si la première
meurt en bas âge, la seconde épousera, quelques années
plus tard et sans le moindre problème, l'élu sans
"e" de son cœur...

Tout
généalogiste découvre un jour ou l'autre,
une anomalie au document qu'il consulte : annotation, page déchirée,
voire dérobée... Évidemment, il faut alors
aussitôt signaler le forfait.
Ci-dessous,
une copie extraite d'un registre de la paroisse d'Orenhoven
[471]
montre l'acte de baptême d'Elisabeth
Deom du 23 septembre 1806. Une personne a reporté dans
la marge, l'identité de chaque enfant baptisé. Cela
est inadmissible même si l'intention était de faciliter
les recherches de futurs généalogistes.

Ici,
en reportant "Elis. Dahm" on a, de surcroît,
commis une grave erreur. Mis en péril car de plus en plus
manipulés et même profanés, les registres,
nous l'avons déjà souligné, seront heureusement
très bientôt entièrement retirés et
échangés par des copies. Déjà en Belgique,
- et depuis plusieurs années -, tous les originaux ont
été remplacés soit par des photocopies soit
par des microfilms. Pour le chercheur le contact n'est plus le
même mais il faut bien admettre que cette mise à
l'écart s'imposait indéniablement. Et puis, les
doubles présentent l'avantage de pouvoir être photocopiés
authentifiant et enrichissant ainsi notre propre documentation.
En
1996, aux Archives Départementales de la Moselle à
Metz, on nous remit un dossier ficelé et composé
d'une liasse d'environ dix centimètres d'épaisseur
contenant une partie des actes notariés de Fénétrange
de l'année 1814
[472]
. Après avoir constaté
que le document était éventré, nous en avons
aussitôt averti le président de la salle de lecture.
Ce dernier ne montra pas le moindre étonnement : "c'est
un éclat d'obus qui a fait ces dégâts, les
brûlures que vous voyez là, sur la circonférence
du trou, le prouvent. Cela s'est passé au cours de la Seconde
Guerre mondiale..."
Les feuilles étaient imbriquées les unes dans les
autres et il fallait donc les détacher précautionneusement.
Au fur et à mesure, le trou devenait toujours moins évasé
et tout au fond nous eûmes la surprise de découvrir…
un éclat d'obus !
[473]
Conclusion
: nous sommes donc les premiers à avoir consulté
ces documents depuis la fin de la guerre ! Peut-être même
depuis qu'ils ont été rédigés ?
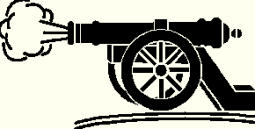
Notre
famille s'est considérablement agrandie au cours du 20ème
siècle et même si le net ralentissement des naissances
[474] , constaté depuis une
bonne vingtaine d'années, se poursuivait, il se passera
des siècles avant que notre nom ne disparaisse de la
surface du globe ! Jamais, en effet, nous n'avons été
aussi nombreux !
Il est
certain que les records de longévité vont être
pulvérisés. Les spécialistes prévoient
d'ailleurs qu'il y aurait 18 000 centenaires en France
en 2010 alors qu'on n'en comptait que 200 en 1953 et 5000
en 1995 !
|
|
Dans
notre famille, Charlotte de Maizières-la-Grande-Paroisse
est décédée récemment
alors qu'elle venait de fêter ses 97 ans et
Anne-Marie, la doyenne du rassemblement du 1er
mai 1994, nous a quittés en 1999 à l'âge
de 98 ans et demi. Rappelons que c'est Mary-Bertha
Deom du Perry County, Indiana, qui a, pour l'instant,
réalisé le parcours le plus long ayant
vécu durant 99 ans et 8 mois !
Nul doute que nous fêterons très prochainement
le premier centenaire de notre famille...
|
Remarquons encore que l'acte de décès de Jean
Déom de Narcimont, consultable dans les registres de
Léglise à la date du 5 octobre 1798, précise
qu'il avait 99 ans à sa mort. Or Jean était
né à Gennevaux le 13 août 1707 ! …
Nous
allions presque oublier de vous dire que si nous n'avons toujours
pas trouvé de baron ou de comtesse parmi nos ancêtres,
Jean Deum de Rancimont fut tout de même écuyer
! La preuve nous est donnée dans un acte daté
du 31 mai 1660
[475] par lequel Jean Deum "escuÿer
de son art, cède et transporte irrévocablement
et pour toujours la succession qu'il a hérité
de père et mère aux bans d'Anlier et de Mellier
à François le Maÿer dudit Rancimont et
Isabeau Deum ses chers beau frère et sœur à
cause de la singulière affection qu'ils luÿ ont
toujours tesmoigné."
À
notre connaissance, ce Jean Deum, qui était le fils
de Jean Deum et de Marguerite Pierson, ne laisse aucune descendance.
C'est pour cela, sans aucun doute, qu'il lègue ses
biens à sa sœur
[476] et à son beau-frère.
Cette déduction implique donc que pas un seul des "Descendants
de Guillaume Deum" n'a le moindre soupçon de sang
bleu dans ses veines. En provenance des "Deum" du
moins...

Voilà
donc, telle qu'elle nous est connue aujourd'hui, l'Histoire
d'une grande et vieille famille. Nous la découvrons
à Gennevaux au début du 16ème
siècle. En fait, la famille Deum existait alors depuis
déjà deux ou trois siècles. Un jour,
quelqu'un trouvera peut-être la clé permettant
de lever le voile sur les préliminaires de cette fabuleuse
marche en avant retracée ici, de notre mieux, sur presque
cinq siècles. Mais sera-t-il possible, un jour, de
connaître l'endroit abandonné par les Deum lorsqu'ils
se sont établis à Gennevaux ? Durant des années,
nous pensions pouvoir prouver qu'ils étaient venus
d'Espagne en même temps que se mettait en place le régime
de Charles Quint. Cette hypothèse n'ayant pu être
démontrée, nous nous contenterons de dire que
Gennevaux, paroisse de Léglise en Ardenne, est le berceau
de notre famille ! Il n'est d'ailleurs pas impossible que
la naissance de notre nom ait tout simplement eu lieu là…
Mais
beaucoup d'autres découvertes restent encore à
faire. Au niveau du destin des filles "Deum", par
exemple. Nous nous sommes trop souvent contentés d'enregistrer
leur mariage et leur décès. Entre ces deux événements,
elles ont presque toutes été maman, certaines
de nombreuses fois. Le simple recensement de ces naissances
représente déjà un travail de longue
haleine assorti de nombreux déplacements. Une autre
démarche, très intéressante, consisterait
à trouver la filiation des garçons que les filles
"Deum" ont épousés. Mais ne faudrait-il
pas ensuite établir l'ascendance des épouses
"Deum" que sont nos mères, nos grands-mères...
Ne nous ont-elles pas donné la vie et transmis leurs
gènes ?
|
Nous
avons :
21 = 2 parents,
22 = 2x2 = 4 grands-parents,
23 = 2x2x2 = 8 arrière-grands-parents.
24 = 2x2x2x2 = 16 "arrière-arrière-grands-parents".
Nos ancêtres de la 10ème génération
sont donc au nombre de :
210 = 2x2x2x2x2x2x2x2x2x2 = 1 024 !
Il aura donc fallu la contribution de :
210 + 29 + 28 + 27
+ 26 + 25 + 24 + 23
+ 22 + 21 = 2 046 personnes
pour engendrer l'être unique que nous sommes !
Selon notre propre expérience, les 1 024
aïeux de la 10ème génération
sont, en moyenne, nés vers le milieu du 17ème
siècle si vous avez aujourd'hui environ 30 ou
40 ans.
Si on continue le raisonnement on arrive, vers la fin
du premier millénaire, à un nombre d'ancêtres
plus élevé que le nombre d'habitants qu'il
y avait alors sur la terre ! Alors ?
Il
faut souligner que cette argumentation n'est exacte
qu'en théorie. Plus on remonte dans le temps
et plus souvent apparaissent des ancêtres revenant
plusieurs fois sur des branches différentes de
notre arbre à la suite de mariages entre cousins
à des degrés plus ou moins éloignés.
Mais de toute façon, il vous reste tout de même
encore de nombreuses recherches à faire…
|
Toutes
ces recherches, qui mériteraient assurément
d'être faites, demanderaient des années de minutieuses
et passionnantes investigations. Il est vrai que le jour viendra
où les actes d'état civil seront numérisés.
Alors on pourra échanger des données avec leur
diffusion sur le web. Il suffira alors de donner quelques
indications à l'ordinateur qui s'empressera de vous
trouver tous les renseignements recherchés. Facile
! Trop facile, car le chercheur n'éprouvera plus la
joie de la découverte venant récompenser sa
patience et son labeur. Et puis, il ne connaîtra plus
ni la chaude ambiance de certaines salles de lecture, ni la
solidarité et la complicité des généalogistes
amateurs qui s'y donnent rendez-vous !
Mais il faut bien vivre avec son temps...
En attendant,
c'est avec beaucoup de joie que nous vous avons livré
ici tout ce que nous avons appris sur notre famille. Avec
l'espoir de vous avoir donné quelque bonheur ! Dans
ce cas, serait prouvé le bien-fondé de l'adage
:
"Le
plaisir le plus délicat est de faire le plaisir d'autrui."
Alors
quand cet autrui est un cousin, même lointain...
Serémange,
le 29 février 2000.
[450]
A.E. Arlon, notaire Ponce Orban n°56,
acte n°4041. Henri-Joseph Déom est né le 11.4.1787
à Cousteumont.
[451]
A.E. Arlon, notaire Ponce Orban n°56,
acte n°4046.
[452]
Rappelons que sous l'ancien Régime,
tout individu âgé de vingt cinq ans accomplis est
dit majeur ! Mais depuis la promulgation du Code Napoléon,
le 21.3.1804, la majorité a été fixée
à 21 ans.
[453]
A. E. Arlon : "Département des
Forêts" n°224/27 au 1er floréal
de l'an 11 de la République.
[454]
Le 13 janvier 1802.
[455]
Il s'agit de Charleville-Mézières : voir A. E.
Arlon, Hypothèques Arlon, n°1188, acte n°52 du
12.5.1860.
[456]
Entre 1950 et nos jours, la mortalité infantile dans
notre famille est de 1,6 %. Rappelons que les enfants décédés
au cours de leur première année ainsi que les
enfants mort-nés entrent dans cette catégorie.
En 1991, la mortalité infantile était tombée
à 0,84% en Belgique, à 0,73% en France et à
0,89% aux U.S.A..
[457]
Réalisées par l'Institut National de la Statistique
et des Etudes Economiques (INSEE).
[458]
Voir "Républicain Lorrain" du 24.9.1996, selon
l'Institut National d'Études Démographiques.
[459]
Avant 1792, c'est l'autorité religieuse et seulement
elle qui établissait et conservait les actes d'état
civil.
[460]
Ces centres sont appelés Archives Départementales
en France et Archives de l'État en Belgique.
[461]
Lors de la 2ème biennale de généalogie
organisée par la Revue française de Généalogie
qui s'est tenue à Paris les 11 et 12 décembre
1999, il a été longuement question d'une réforme
possible concernant les archives. Les délais de communication
des actes d'état civil seraient abaissés prochainement.
On parle de supprimer carrément ces délais pour
les actes de décès. Les actes de mariages seraient
accessibles au bout de 20 ou 30 ans. Les actes de naissances,
par contre, resteraient toujours à l'abri des regards
indiscrets. On parle ici de raccourcir très légèrement
les 100 ans actuellement en vigueur. Quand imiterons-nous la
Grande-Bretagne où ces délais ont été
entièrement supprimés depuis longtemps ?
[462]
Soit environ 3,6 € .
[463]
Quittance.
[464]
Dans les centres d'archives la photocopie d'un acte à
partir d'un registre est strictement interdite.
[465]
La mairie de Nuremberg nous apprit qu'elle ne possédait
les registres d'état civil que depuis 1876 et nous dirigea
ainsi vers l'évêché.
[466]
Soit environ 21 euros. "Archives personnelles" : voir
lettre n°1683 du 15.11.1998.
[467]
Recherche infructueuse.
[468]
Principalement Eleanor Deom d'Evansville et Susan Deom de Tell-City.
Sur l'ensemble des recherches, on peut estimer à environ
10% la quantité de renseignements obtenus de certains
membres de notre famille.
[469]
La bibliothèque généalogique centrale des
Mormons est située à Salt-Lake-City dans l'état
d'Utah (U.S.A.). En 1992, on pouvait déjà y consulter
gratuitement plus de 1 500 000 bobines de microfilms
réalisés dans de nombreux pays (Belgique, France,
Italie, Allemagne, Grande-Bretagne, États-Unis, Québec,
Inde, Russie, Japon, etc.)
[470]
11, Rue Bompar. Tél. : 03 87 36 82 35
[471]
Archives déposées à l'Évêché
de Trèves (Allemagne).
[472]
A. D. Moselle (Metz) : "336U15".
[473]
La série "L" qui comprenait les actes notariés
et les documents de la période révolutionnaire
de la Moselle était conservée au fort St Quentin
et fut détruite par le feu dans la nuit du 31.8 au 1.9.1944.
[474]
Ce ralentissement est, bien entendu, général.
En France, en 1962, une femme avait en moyenne 2,83 enfants
au cours de sa vie. En 1990, elle en a encore 1,78 !
[475]
"Œuvres de loi" de Mellier
n°1554, page 98. Jehan Deum est né vers 1608.
[476]
En fait, Isabeau est la demi-sœur de
Jean
|